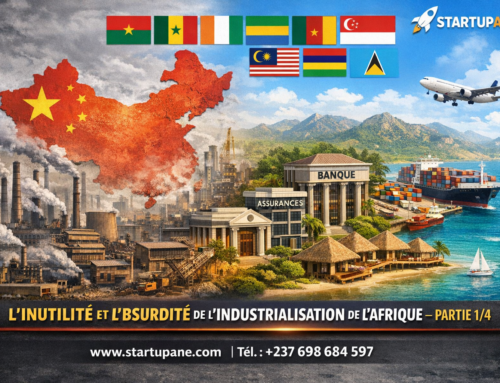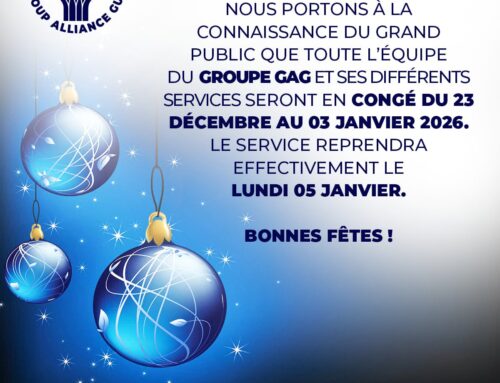Texte : 5263 mots – Temps de lecture : 25 mn – Auteur : TCHAKOUTE Ernest – Douala – le 16/09/2021 – 17H24 –repost le 19/10/2025 –12h44 – type de texte : #Géopolitique #veille_stratégique #veille_concurrentielle – guerre_économique.
VOICI COMMENT ON A ENCORE TROMPÉ LES AFRICAINS.
Au départ cette histoire était de la générosité… Aujourd’hui, quand ça arrive au tour des Africains, ça devient un piège.
Bravo ! À ceux qui l’ont compris, pour ceux qui ne l’ont pas compris, sachez qu’il s’agit de la friperie. He oui! Je sais que beaucoup se diront : « Mais il raconte quoi celui-là ? » Lisez la suite, vous comprendrez comment, une fois que c’est arrivé à notre tour, les choses ont changé.
L’histoire de la friperie est une histoire digne des films westerns. Lisez, vous comprendrez tout dans les lignes qui suivent.
L’histoire de la friperie est assez complexe, pour ceux qui ne connaissent pas, vous serez surpris par son origine. Sachez que les premières friperies étaient à destination de l’Europe.
POURQUOI ET COMMENT L’EUROPE SE RETROUVE AU CENTRE DE LA FRIPERIE ?
À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, le Vieux Continent (l’Europe) est à genoux et si pauvre au point où il devenait impossible de s’habiller et l’Amérique, qui sort enrichie du conflit, entreprend un vaste mouvement de générosité à l’endroit de leurs cousins européens. Aussi, les dons de vêtements usagés ont commencé à affluer.
Puis, le temps est passé, les Européens se sont retroussé les manches pour bosser dur ; au fil des années le pouvoir d’achat des populations s’est amélioré, par la suite le prix des textiles a baissé.
Par la force des choses, ils n’avaient plus besoin des habits usés provenant des USA. Cependant, les Américains persistaient à expédier leurs vêtements usagés hors de leur territoire.
L’Europe ne pouvant plus absorber ces déchets, les Américains ne sachants plus quoi en faire se réunissent avec des organismes caritatifs afin de trouver une issue à ses déchets qui s’amassaient chaque jour un peu plus.
C’est ainsi que les organismes ont eu l’idée originale d’envoyer ses déchets en Afrique. Tenez-vous tranquille cette fois-ci, non plus forcément pour les donner aux pauvres, mais pour les vendre aux Africons (comme dirait quelqu’un) et dégager de petites ressources financières.
Après cette réunion, les Américains flairent vite le business qui se met en place et s’organisent rapidement en un circuit formel.

Ainsi ils créèrent une association spécialisée dans ce type d’activités : la SMART (Secondary Materials and Recycled Textiles Association), une entité qui regroupe les vendeurs de produits et textiles de seconde main. N’oubliez pas que la collecte est gratuite. Ce n’est pas un hasard, si les USA sont le deuxième vendeur de vêtements de seconde main dans le monde, après le Royaume Uni.
Aujourd’hui, grâce à l’Afrique, cette situation qui au départ était de la générosité est devenue un business et un outil de pression géopolitique car il fait un chiffre global estimé à 5 milliards d’euros. Et bien plus si on compte le prix de la revente sur le juteux et vaste marché africain.
Cette situation nous conduit à nous intéresser à la question des effets négatifs de la friperie sur la production textile locale.
L’ÉTUDE DU VÊTEMENT DE SECONDE MAIN SUSCITE DEPUIS PEU UN INTÉRÊT GRANDISSANT.
Depuis des années, des études sur l’impact tant social qu’économique du commerce de vêtements de seconde main dans les pays en développement ont été réalisées au cours des dernières années, relevant tant des bienfaits que des méfaits de l’expansion rapide de ce commerce.
Le commerce de la friperie comporte des conséquences graves sur les économies des pays africains et particulièrement sur le secteur de l’industrie textile. À l’instar de l’aide alimentaire, il est de nature à dissuader la production locale. En effet, la pauvreté monétaire qui est ambiante au niveau de certaines couches de la population amène ces dernières à préférer les articles de friperie aux produits textiles fabriqués localement.
L’afflux de vêtements usagés dans les années 1990 est souvent associé à la fermeture de la grande majorité des usines d’habillement et de tissu, qui a occasionné des suppressions d’emploi estimées à 12.000 en Zambie, 20.000 au Zimbabwe, 7000 au Sénégal, 5.000 en Ouganda, 20.000 en Afrique du Sud.
Le Mozambique, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Ghana sont également très touchés. Au début des années 1980, l’industrie textile occupait, en termes d’emploi, la première place dans le secteur industriel du Kenya.
Elle représentait 30% de la main-d’œuvre industrielle et impliquait plus de 200.000 ménages. Mais au début des années 90, cette industrie s’est effondrée et l’importation de vêtements de seconde main était pour beaucoup dans cet effondrement.
UN PEUPLE CURIEUX
Voici où le paradoxe de l’homme noir s’érige en maître absolu. Pour comprendre les effets des vêtements de seconde main sur l’impact économique, une étude a été faite au Zimbabwe, la majorité des tailleurs et producteurs de vêtements ont affiché une neutralité sur la compétition avec le commerce des vêtements d’occasion. Pour eux, les vêtements d’occasion et l’habillement traditionnel sont deux marchés distincts.
En gros, on demande aux gens s’ils sont d’accord qu’on limite l’importation de la friperie afin que leur marché puisse s’agrandir ? Ils disent non, ça me va comme ça. Surtout ne soyez pas étonné, la question que vous devez vous poser est celle de savoir quel habit il a sur lui lors de l’enquête ? Bien évidemment il a la friperie au corps, il est normal qu’il ne trouve aucun inconvénient à faire venir la friperie pour tuer son propre marché.
C’est l’histoire de ce couturier vêtu d’un pantalon jeans cousu en Chine, qui se plaint que les gens n’encouragent pas les couturiers locaux, un paradoxe terrible ; lui-même ne porte pas son habit pour faire la publicité et voudrait que ce soit l’autre qui le fasse.
UNE NORMALISATION EFFRAYANTE DE LA PAUVRETÉ
Le commerce des vêtements de la friperie présente des avantages clairs pour les consommateurs, en particulier pour ceux à faible pouvoir d’achat, ça on ne peut pas le nier. À court terme, les importations de friperie permettent aux populations de s’habiller à bas prix.
Les partisans de ce commerce pour soutenir cette activité vous diront que le commerce de friperie soutient les vies des centaines de milliers de personnes dans les pays en voie de développement. Et diront que la friperie est fortement génératrice d’emplois, l’activité directe du tri génère en effet des emplois salariés sans qualification, et fait appel à des prestataires extérieurs pour laver et réparer les vêtements.
La vente est elle-même pourvoyeuse de nombreux emplois dans les villes et les villages : grossistes, revendeurs, petits commerçants sur les marchés, tailleurs transformateurs de la fripe. Plus de 5 millions de personnes (sur une population d’environ 30 millions) sont affectées directement ou indirectement par les échanges d’habillement d’occasion du Kenya.
Bien que n’ayant créé que des emplois précaires et instables (sans contrat de travail, sans droits, sans sécurité…) ce qui est terrible, c’est que cette situation ne choque personne dans un pays où presque 20% de la population sont impliqués dans une activité précaire. Comment comptent-ils développer un pays avec des emplois précaires ?
En Afrique, les vêtements d’occasion constituent, dans la majorité des cas, la garde-robe de gens ordinaires. Plus d’un quart des vêtements portés ici proviennent de la friperie.
EN QUOI LA FRIPERIE EST SENSIBLE ?
Il faut dire qu’avant, L’importation de la friperie générait d’importantes recettes fiscales pour le budget de l’État. Par exemple elle était taxée au taux de 30% aux douanes congolaises.
Pour ne rien arranger, les APE sont venus et la friperie a subi une réduction considérable du taux d’imposition.
Comme la farine de blé, les cigarettes, la friperie est considérée comme un produit sensible par les gouvernements africains.
Relativement peu important dans les années 80, le marché de la friperie connaît aujourd’hui une véritable explosion au Congo-Brazzaville. Venant des grands pays fournisseurs à l’instar de l’Europe occidentale (Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne et Italie) et de l’Amérique du Nord, la friperie représente 39,91% des produits industriels textiles importés dans le pays.
ET LE CAMEROUN DANS TOUT ÇA ?
Le Journal Agence Ecofin dans son article du 19 septembre 2020 dit qu’en 2019, le Cameroun a dépensé 101,7 milliards FCFA pour importer la friperie et les matières textiles (+6,4%)’
Le Journal disait ceci : « Parmi ses importations textiles qui s’élèvent à plus de 100 milliards FCFA, le Cameroun a dépensé en 2019 près de 40 milliards FCFA pour importer 73 170 tonnes de vêtements de seconde main.
Le Cameroun a dépensé une somme de 101,71 milliards DE FCFA en 2019 pour l’importation de 121 935 tonnes de matières textiles et leurs ouvrages, dont la friperie, soit une hausse de 6,4%.
Dans le détail, la soie (135 tonnes) a absorbé 117 millions FCFA, la laine et les poils (12 tonnes) 6 millions FCFA. Le coton (794 tonnes) a coûté 1,427 milliard FCFA. Les autres fibres textiles végétales (4899 tonnes) ont englouti 3,803 milliards FCFA. Les filaments synthétiques ou artificiels (11 305 tonnes), 11,111 milliards FCFA. Les fibres synthétiques ou artificielles (2580 tonnes), 4,4 milliards FCFA. Les ouates et feutres (2711 tonnes), 2,912 milliards FCFA.
Le pays a déboursé 2,527 milliards FCFA pour les tapis et revêtements de sol (4104 tonnes). Les tissus spéciaux (194 tonnes) ont coûté 236 millions FCFA. Les tissus imprégnés (398 tonnes), 823 millions FCFA. Les étoffes de bonneterie (23 tonnes), 39 milliards FCFA. Les vêtements en bonneterie (5390 tonnes) ont absorbé 8,045 milliards FCFA. Les vêtements autres qu’en bonneterie (2932 tonnes) ont coûté 4,393 milliards FCFA.
Les autres articles textiles confectionnés (86 458 tonnes) ont coûté 61,879 milliards FCFA ; les sacs et sachets d’emballage (2570 tonnes), 4,337 milliards FCFA. La friperie (73 170 tonnes) à son tour a coûté 39,482 milliards FCFA. »
Notez bien qu’ici on ne parle que du textile, on n’a même pas parlé des véhicules d’occasion, des équipements d’intérieurs et de bâtiments.
— –PARTIE 2 —
QUAND LA FRANCE MENACE LA COTE D’IVOIRE
Afin de comprendre les choses, il faut replanter le décor. Ceci n’est qu’un exemple pour vous donner la profondeur du mal et vous faire comprendre que si nous ne prenons pas des mesures aujourd’hui, nous aurons condamné l’avenir de nos enfants et consommer la poubelle des autres.
Afin d’assainir le parc automobile ivoirien, le président de la République Alassane Ouattara signait le décret n° 2017-792 du 06 décembre 2017 qui entra en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2018. Le texte limitait les importations de vieux véhicules de tourisme de plus de 5 ans. La mesure visait à réduire le nombre d’accidents et les émissions de gaz à effet de serre. Car jusque-là, 75 % des « France au revoir », le surnom des véhicules d’occasion importés, avaient entre 16 et 20 ans, faisant du parc automobile ivoirien le plus vieux d’Afrique de l’Ouest ; des voitures le plus souvent recalées au contrôle technique en Europe et qui venaient polluer le territoire ivoirien.
Lisez la réplique du journal Le Monde du 06 juin 2019
Voici le titre de l’article » Côte d’Ivoire : les oubliés du port d’Abidjan »
Rien que le titre est déjà alarmiste. Sauf qu’il ne faut pas être dupe, lisez la suite de l’article, je vous dirai quelque chose de terrible à la fin.
Le journal écrit : « Mohamed est un peu perdu. Six mois qu’il n’a pas mis les pieds au port d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, et il ne retrouve plus la route. Une fois sur place, l’ancien transitaire reconnaît à peine les petits commerces au bout des docks et le parking de l’embarcadère, désespérément vide. Quel contraste avec ce même lieu un an auparavant, quand des centaines de véhicules de tous âges attendaient un acheteur ! »
Selon eux, l’emploi de Mohamed est plus important que le risque d’accidents et la santé des millions d’Ivoiriens ? Drôle de journal ! Ce n’est pas fini Continuez la lecture, vous comprendrez que ces gens sont des sans-cœur.
Le journal continue en disant ceci : « du jour au lendemain, au port, le nombre de voitures d’occasion importées d’Europe et d’Amérique du Nord (plus de 50 000 par an) a chuté et des milliers de travailleurs se sont retrouvés sur le carreau. Comme Mohamed, qui gagnait plus de 500 000 francs CFA par mois (plus de 760 euros), soit huit fois le salaire minimum ivoirien, et vivait confortablement. Aujourd’hui, il se débrouille en revendant des mocassins au marché (…).
Le journal continue et dit ceci : « Les rares voitures importées aujourd’hui sont quasiment neuves et les prix ont flambé. Entre 10 et 15 millions de francs CFA (de 15 000 à 23 000 euros), soit cinq fois plus qu’avant. « Le président n’a pas pris en compte le volet social. Le développement doit être beaucoup plus humain », juge Sylvestre Kouakou. Selon les membres du syndicat, cette réforme pousse encore plus de gens à prendre la route de l’exil. « Beaucoup sont déjà partis, il n’y a pas de perspectives ici. Moi aussi, je suis en train de réfléchir à partir en Europe », confesse Henri Konan, dépité. »
Il faut le dire, ces gens sont dotés d’une capacité de manipulation et de nuisance terrible si on ne fait pas attention, on finit par tomber dans le piège.
Certains penseront qu’ils font ce reportage par pur humanisme ou par pure compassion pour ces pauvres Ivoiriens que le gouvernement a décidé de balancer dans la rue en plein jour comme des malpropres.
ILS SONT DANS UNE DYNAMIQUE D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE.
Cette partie vous fera comprendre les enjeux réels dissimulés derrière le reportage. N’oubliez surtout pas de partager l’article avec vos amis et famille pour que personne ne reste dans l’ignorance.
QUE DIT LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE) ?
Dans un rapport édité, intitulé « Les véhicules d’occasion et l’environnement – Un aperçu global des véhicules utilitaires légers d’occasion : débit, échelle et réglementation », le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a analysé les flux de véhicules d’occasion dans le monde. Selon l’organisation, des millions de voitures, fourgonnettes et minibus d’occasion de piètre qualité sont exportées depuis l’Europe, les États-Unis et le Japon vers les pays en développement. Dans son rapport, elle estime que 14 millions (plus que la population du Gabon, Comores, Seychelles, cap vert, Guinée Equatoriale, Guinée Bissau, Djibouti, l’ile Maurice) de véhicules légers d’occasion ont ainsi voyagé dans le monde sur la période de 2015 à 2018. Environ 80 % de ces exportations ont été effectuées vers des pays à faible ou à moyen revenu. Ce sont les pays africains qui ont importé le plus grand nombre de ces véhicules d’occasion (40 %) au cours de la période étudiée, suivis par les pays d’Europe de l’Est (24 %), d’Asie-Pacifique (15 %), du Moyen-Orient (12 %) et d’Amérique latine (9 %).
Comme quoi nous avons explosé tous les records en étant les premiers du monde à importer la poubelle des autres, il faut être un naïf absolu pour ne pas comprendre que le fait de cesser d’importer ces vieilleries sous-entend que la France se retrouvera avec sa propre poubelle sous la main.
Et par ce canal, le journal « Le Monde » essaie d’influencer les consciences et disant comment nos chefs d’État n’excellent que dans les mauvaises décisions.
Lisons la suite. Vous comprendrez que leurs poubelles les étouffent déjà et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) dit ceci : l’Union européenne a exporté environ 7,5 millions de véhicules d’occasion vers des pays extérieurs (3,9 millions pour le Japon et 2,6 millions pour les États-Unis), principalement vers l’Afrique de l’Ouest et le bloc EOCAC (Europe de l’Est, Caucase et Asie centrale). Sur le seul exercice 2018, l’UE a exporté un peu plus d’un million de véhicules légers d’occasion vers l’Afrique (sur un total d’environ 1,5 million de véhicules importés en Afrique cette année-là). Selon l’organisation, tous ces flux « contribuent de manière significative à la pollution atmosphérique et entravent les efforts visant à atténuer les effets du changement climatique ». Le constat n’est pas nouveau. Cela fait déjà des années qu’il est reproché aux pays occidentaux, le Vieux Continent en tête, de « se servir de l’Afrique comme dépotoir ». Ceux-ci profitent des réglementations très souples en vigueur dans bon nombre de pays africains importateurs.
À ceux qui pensent que la France est l’amie des pays africains… Est-ce qu’on déverse ses ordures chez son ami ?
Une étude récente menée par les Pays-Bas a révélé que la plupart de ces véhicules ne possédaient pas de certificat de contrôle technique valide au moment de l’exportation. La plupart étaient âgés de 16 à 20 ans et en dessous des normes d’émission Euro 4 de l’Union européenne pour les véhicules.
Sachant que les Français sont un peuple qui fait des prospections quand vous allez sur le site de la douane Douane.gouv.fr, vous voyez que la douane française dit que ce sont 11 503 véhicules d’occasion qui ont été exportés vers l’Afrique en 2019 (– 7,6 % par rapport à 2018), dont 7 083 équipés d’un moteur diesel et 4 406 d’un moteur à essence.
Cette baisse les inquiète, raison pour laquelle ils doivent mettre la pression sur nos gouvernements en faisant des reportages pour démontrer le côté inhumain du décret du président Alassane Ouattara, qui interdit d’importer la mort et la pollution. Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) finit le rapport et rappelle exactement ce que j’ai dit plus haut, que les véhicules d’occasion de mauvaise qualité entraînent également une augmentation du nombre d’accidents de la route. De nombreux pays ayant une réglementation « très faible » ou « faible » sur les VO, affichent également un taux de mortalité routière très élevé.
Les données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) indiquent qu’en 2002, près 1,2 million de personnes sont décédées dans le monde des suites de traumatismes dus à des accidents de la circulation routière. Le coût annuel total des accidents de la circulation routière pour les pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires est estimé à 65 milliards de dollars US, ce qui est plus élevé que le montant de l’aide au développement. Les pays africains continuent de payer un lourd tribut à ce fléau social. Par exemple, le risque d’accident mortel est plus élevé en Tanzanie et au Kenya où il avoisine 60 tués pour 10 000 véhicules. Voici les informations que le journal prend soin d’ignorer et évite volontairement de mettre à la disposition du grand public.
Le journal Le Monde ne nous dit pas qu’en Côte d’Ivoire l’Office de Sécurité Routière (OSER) a mené une étude transversale et analytique qui s’est déroulée de février à juin 2013 et a porté sur les accidents de la circulation routière survenus en Côte d’Ivoire de janvier 2002 à décembre 2011, c’est-à-dire une période de dix ans.
Les résultats ont donné que les routes ivoiriennes ont fait plus de 54 000 accidents de la route avec de nombreux morts dans lesquels les voitures d’occasion sont la cause. Ils ne parlent pas de ces nombreuses familles endeuillées à cause des vieilles voitures, ils trouvent plus à dire sur le cas des gens qui gagnaient 500 000 par mois.
Dans son reportage, il cherche à démontrer comment 15 000 personnes dans la rue est une catastrophe nationale. À aucun moment il ne mentionne qu’en Afrique les familles sont étendues et pas nucléaires, comme chez eux, c’est-à-dire qu’en Afrique un parent à lui seul a parfois 15 personnes à sa charge et que la disparition de cette personne, c’est une bonne frange de la population qui se voit plonger dans l’abîme du désespoir. Comprendre la différence entre les deux types de familles. La famille nucléaire est composée d’un ou deux parents et de leurs enfants, tandis que la famille étendue (ou élargie) inclut ces membres ainsi que d’autres parents comme les grands-parents, oncles, tantes et cousins au sein du même foyer ou à proximité. La famille nucléaire est traditionnellement associée à la société occidentale, tandis que la famille étendue est caractérisée par des liens intergénérationnels forts, une solidarité et un partage des tâches et des traditions qui sont propres à la société africaine.
C’est ça, faire de l’intelligence économique. Le cas des véhicules n’est qu’à titre d’illustration afin de faire comprendre comment nous sommes pris dans un piège.
Celui qui pense avoir tout lu qu’il reste calme, la suite du texte lui fera comprendre que la situation est plus qu’alarmante.
PARTIE 3
CECI EST UNE SONNETTE D’ALARME.
Étant donné qu’aux yeux des autres, l’Afrique reste l’eldorado et vu que la Chine n’a pas réussi à déclasser la friperie sur le marché africain, il faut garder à l’esprit que cette dernière et l’Inde sont en train de se préparer pour prendre d’assaut le marché africain cette fois-ci pas avec les vêtements neufs mais comme les autres avec la friperie et leurs déchets industriels car il faut le dire ils en produisent et en quantité. Un moment viendra où ils chercheront un dépotoir.
D’après les chiffres de la Banque mondiale, la croissance mondiale aurait atteint 2,6 % en 2024, tirée par le net redressement de quelques grandes économies. Soutenue par une stabilité et un léger rebond de certaines grandes économies comme l’Inde. Et la vigueur de la reprise mondiale à court terme tient essentiellement à une poignée de grandes économies comme les États-Unis et la Chine, tandis que de nombreuses économies émergentes et en développement sont à la traîne. Selon les prévisions, ces deux pays représenteront chacun plus d’un quart de la croissance mondiale, la contribution des États-Unis étant pratiquement trois fois plus élevée que son niveau moyen sur la période 2015-19. Cette croissance mondiale sera plus robuste que prévu. Comme nous l’avons dit plus haut, ces progrès sont toutefois principalement concentrés dans les économies avancées. Et une révision à la baisse des prévisions de croissance pour les pays moins riches.
Selon les estimations, en 2025 l’Inde est le pays le plus peuplé au monde avec 1, 441,72 milliards d’habitants et la Chine 1, 425,18 milliards d’habitants. Les USA viennent en troisième position avec 341,81 millions d’habitants.
Il est important de noter que l’Inde a dépassé la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde en 2023, marquant un changement démographique historique.
LA CHINE, PREMIÈRE ÉCONOMIE MONDIALE DÈS 2028
À en croire un think tank britannique, les États-Unis seront détrônés cinq ans plus tôt que ce qu’annonçaient les précédentes prévisions. En ces temps de récession, l’économie chinoise a rebondi plus rapidement.
Ce n’est pas là son habitude. Mais en fin d’année 2020, le Centre for Economics and Business Research (CEBR) de Londres ne liste pas les croissances les plus fortes. Il se contente de mettre en avant les économies qui ont le mieux limité les dégâts. Et dans ce concours, la Chine est celle qui s’en tire le mieux, selon le classement annuel que le cercle de réflexion britannique a publié le samedi 26 décembre et que The Guardian relayait sur son site internet. Au point, annonce-t-il, que l’économie asiatique détrônera sa rivale américaine avant la fin de la décennie, en 2028 précisément.
“La Chine a rebondi rapidement après les premiers effets de la pandémie de Covid-19 et sa croissance s’élèvera à 2 % en 2020”, rapporte The Guardian. “Tandis que l’économie américaine se contractera de 5 %, la Chine réduira l’écart avec sa grande rivale.” À l’échelle planétaire, la croissance devrait reculer de 4,4 %, la pire contraction depuis la Seconde Guerre mondiale.
Cependant il faut noter qu’en Asie, la Chine ne fait pas figure d’exception. Selon Douglas Mc Williams, vice-président du CEBR, “d’autres économies asiatiques grimpent aussi dans le classement.
Les dirigeants politiciens africains, dont les résultats pendant la pandémie sont plutôt moins graves, au lieu de passer leur temps à vouloir jouer les malheureux en demandant de l’aide à l’Occident quand bien même cette dernière a été moins touchée, devraient en tirer une leçon et se montrer plus attentifs à ce qui se passe en Asie au lieu de simplement s’observer les uns les autres”.
Le Japon conserve sa troisième place mondiale et devrait la garder jusqu’au début des années 2030, selon le CEBR. Mais, à l’horizon 2035, l’Inde pourrait la lui ravir. “Après avoir détrôné la France et le Royaume-Uni en 2020, l’Inde est repassée derrière le Royaume-Uni en raison de l’écroulement de la valeur de la roupie, analyse The Guardian. Mais ce plongeon sera de courte durée.”
VOICI Où TOUT SE JOUE
La croissance relative du revenu par habitant correspond à l’écart de croissance du PIB par habitant entre les économies émergentes et en développement et les économies avancées.
La pandémie a inversé ou ralenti le processus de convergence entre les économies avancées et les économies émergentes et en développement.
Dans de nombreuses économies émergentes et en développement, le taux de croissance du revenu par habitant restera inférieur à celui des économies avancées. La dynamique de rattrapage par rapport aux économies avancées a donc ralenti ou s’est même inversée, surtout dans les pays les plus pauvres et les plus fragiles. Ceci sous-entend que les pays africains pauvres seront de plus en plus pauvres et les pays comme la Chine deviendront immensément riches.
CE QU’IL FAUT COMPRENDRE
À ce jour, les quelque 7 874 966 000 milliards d’êtres humains que nous sommes générons chaque année près de 2,1 milliards de tonnes de déchets (ordures collectées par les municipalités, nourriture jetée, plastiques et détritus divers…). De quoi remplir, quelque 822 000 piscines olympiques.
Ce sont les États-Unis, qui, à eux seuls, sont à l’origine de 12% des ordures dans le monde, alors qu’ils ne représentent que 4% de la population mondiale, soit 773 kg par individu et par an (contre 530 pour la France et 150 au Bangladesh). Ce qui leur vaut d’occuper la première place de l’index de production des détritus dans le monde. Les citoyens américains produisent ainsi sept fois plus de déchets que les Éthiopiens et les Kenyans, les pays qui occupent la dernière place du classement en termes de production de déchets dans le monde. Et comme par magie, nous retrouvons les vieux habits des Américains dans les pays moins pollueurs.
Aujourd’hui l’Amérique est la plus grande économie du monde, elle produit plus de déchets que les autres pays. Il ne sera pas étonnant qu’une fois que la Chine prendra la première puissance mondiale qu’elle soit la plus grosse productrice de déchets, au monde. Sans oublier que l’Inde les regarde de très près.
Une fois que le Chine sera en première place, leurs déchets devront bien évidemment trouver une poubelle ou les déverser et l’Afrique deviendra le paradis absolu et incontestable des déchets du monde et cette fois, on aurait tout accompli en réussissant l’exploit toute seule de recevoir la poubelle de tout le monde parce que jusqu’ici, la Chine manque encore à l’appel car le japon le fait depuis très longtemps. En envoyant les vieilles voitures, les vieux produits électroménagers en Afrique.
Il n’est pas rare de voir un Africain porter les vêtements d’esquimaux dans un pays où il ne neige jamais.
Étant donné que le pouvoir d’achat des Chinois est en train d’augmenter, elle sera confrontée elle aussi à ce problème de déchets et il faudra bien qu’elle trouve un dépotoir. Et l’endroit par excellence reste l’Afrique, Alors préparons-nous et ayons le moral fort pour les recevoir. Car 1 444 216 000 (population Chinoise) d’habitants, ça produit beaucoup de déchets. Peut-être elle ne se passera pas aujourd’hui ou dans 5 ans, mais dans maximum 10 ans les Chinois commenceront à déverser leurs friperies en Afrique.
Soyons juste avertis car lorsqu’ils commenceront à déverser les déchets de leurs 1 444 216 000 de personnes, nous deviendrons une gigantesque poubelle à ciel ouvert.
POUR FINIR, JE DIRAI QU’AUCUN PAYS NE PEUT SE DÉVELOPPER ÉCONOMIQUEMENT SANS PASSER PAR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN.
EN QUOI UTILISER LES DÉCHETS DES AUTRES PEUT CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT HUMAIN D’UNE SOCIÉTÉ ?
CONCLUSION
Il faut savoir que l’envoi des vêtements d’occasion en Afrique coloniale a commencé après la Première Guerre mondiale avec un afflux de surplus d’uniformes militaires embarqués par les marchands de vêtements usagés en Europe et dans les régions de production aux États-Unis. Dans la période post-indépendance, un accent particulier avait été mis, dans bon nombre de pays d’Afrique, sur l’augmentation de la production domestique de tissus et vêtements pour le marché local. Ayant adopté des politiques de substitution des importations, les pays d’Afrique noire ont pour la plupart interdit l’importation d’habillement d’occasion en vue de protéger l’industrie naissante.
Mais avec la détérioration des termes de l’échange, survenue dans les années 80, de nombreux gouvernements ont commencé à les tolérer, pour répondre à la demande des ménages à faible pouvoir d’achat.
LA BATAILLE ENTRE LA CHINE ET L’OCCIDENT
En 2017, le Mali et le Burkina-Faso, deux pays de l’UEMOA, ont été les premiers producteurs de coton en Afrique. Le Cameroun, pays leader de l’Afrique centrale, est un producteur plus modeste de l’or blanc, mais a réalisé les meilleurs rendements de cette culture, avec près de 500 kilogrammes de coton à l’hectare. Ces pays, ajoutés à d’autres comme le Tchad ou le Togo, sont des noms qui comptent dans la production de cette matière première à partir de laquelle sont fabriqués les vêtements. Et pourtant, l’Afrique reste le continent où prospère, plus que jamais, la vente de vêtements de seconde main. Nous sommes en droit de nous interroger : l’Afrique peut-elle se passer de ces importations controversées ?
Je finirai ma réflexion avec une question. la photo a été prise au parcours Vita à Douala. Si tant est que le zone Bonamoussadi à Douala est une zone où la population est dite à revenu moyen, pourquoi quand le pouvoir d’achat des Occidentaux a augmenté ils ont abandonné les friperies, mais du côté des Africains, bien que le pouvoir d’achat ait augmenté, on a toujours les Africains dits moyens qui continuent à fouiller, à chercher et à acheter les vieux vêtements des autres peuples? Comment un citoyen normal peut-il sortir de l’argent de ses poches pour acheter les sous-vêtements d’une autre personne et les porter ?
——————
Si vous venez de me découvrir, je m’appelle TCHAKOUTE Ernest. Je suis entrepreneur multi-casquettes, négociant de matières premières, et intermédiaire financier. J’ai mis sur pied une formation inédite qui change des vies sur l’intermédiation financière. Grâce à ce programme, nous avons créé le plus grand réseau d’intermédiaires financiers africains au monde. Ce programme s’adresse aux personnes qui veulent : – la tranquillité d’esprit – le pouvoir – appartenir à un réseau fermé et élitiste ; – apporter leur contribution à l’élévation du continent – affronter les autres peuples avec confiance.
En un mot, des personnes qui veulent défendre les valeurs africaines tout en gagnant confortablement leur vie. Alors si ceci vous parle, retrouvons-nous du côté de l’île Maurice du 26 au 29 novembre 2025 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial portant sur l’intermédiation financière. Les participants sont des cadres d’entreprises, des ingénieurs, de architectes, des médecins, des responsables de gouvernements et bien d’autres… Alors,
CLIQUEZ RAPIDEMENT ICI bit.ly/3I1ATfh POUR APPARTENIR A CE RESEAU TRES FERME ET ELITISTE.

Douala le 19/09/2025 — 12h22
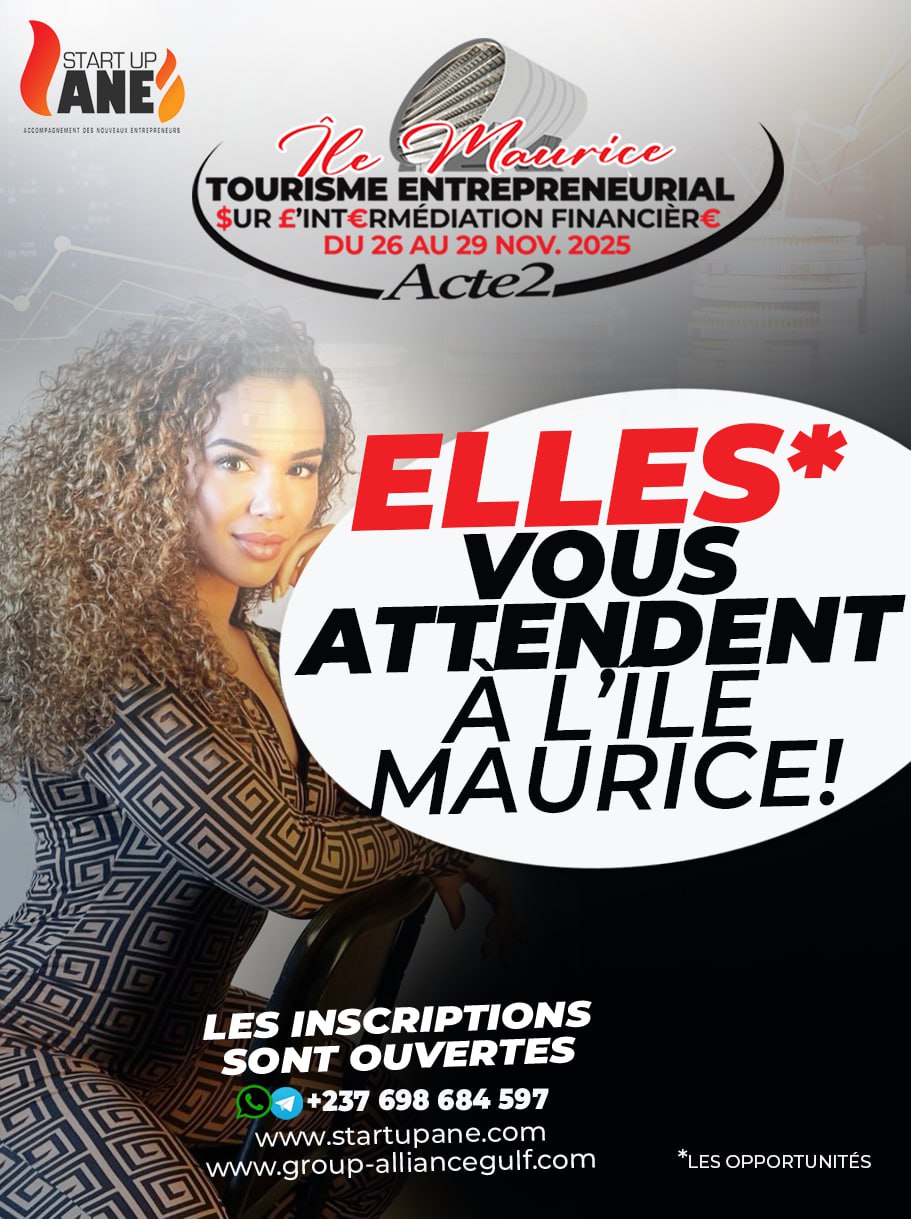
—- —–
2 – https://www.cairn.info/revue-congolaise-de-gestion-2011-2-page-9.htm
3 – https://www.cairn.info/revue-empan-2014-2-page-131.htm
7 – http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?d=1&recordID=8980
9 – https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-5-page-647.htm
10 – https://www.geo.fr/environnement/dans-quels-pays-produit-on-le-plus-de-dechets-menagers-196410
11 – https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/statistiques-du-commerce-exterieur-beaxnet-ng
12 – https://fr.statista.com/statistiques/564934/pays-les-plus-peuples/